Langue de bois à la BRI et économie-baudruche.
Nous aimons bien la Banque des Règlements internationaux qui a presque compris que l’économie mondiale fonçait dans le mur en 2007 et au premier semestre 2008, alors que le FMI s’enfonçait dans l’erreur, sous la tutelle nonchalante de DSK, entraînant la majorité des gouvernements dans la passivité morose.
L’ennui avec les responsables de la BRI, est leur tradition de frôler l’essentiel sans jamais l’atteindre vraiment.
Le dernier rapport est de cette eau-là. Il dénonce trois dangers qui sont réels.
Le premier est d’avoir peur de la finance et de retarder toute action visant à la mettre sous contrôle par peur des réactions sur les marchés.
Le second est pour les gouvernements d’espérer que l’argent presque gratuit des banques centrales leur permettra de retarder indéfiniment les réformes nécessaires, en maintenant un haut niveau de dettes publiques.
Le troisième est la surestimation du pouvoir des banques centrales et du potentiel naturel et automatique de sortie de crise.
Il signale que la seule solution est dans une collaboration très étroite et la prise de conscience que les relations économiques croisées des nations ont une extrême importance.
On reconnaîtra ici un certain nombre de nos thèmes préférés. Nous disons depuis longtemps que les banques centrales sont comme les psychanalystes : elles ne savent soigner que les maladies qu’elles ont créées. De même nous ne croyons pas à la bienveillante main invisible des marchés financiers et monétaires libres, en régime de changes flottants. Enfin nous développons l’idée que ce sont les énormes excédents et déficits croisés de balances extérieures qui ont provoqué la hausse du taux global d’endettement depuis le retournement de 1971-72.
Nous ne cessons d’affirmer que le G.20 a fait un pari pascalien en ne réformant rien du système monétaire international en 2008 et 2009. Et qu’il l’a perdu.
On ne sort pas de la queue de la comète récessive de 2008-2009 parce qu’aucune des mesures globales nécessaires n’a été prise.
Ce que le BRI n’ose pas dire, c’est que pour atteindre les trois objectifs qu’il se fixe il faut prendre une décision majeure : mettre fin aux changes flottants et réactiver les règles du traité de La Havane et du Statut du FMI, qui interdisent les excédents et les déficits massifs de comptes extérieurs.
Si les Etats redeviennent responsables de la valeur externe de leur monnaie, alors ce ne sont plus les marchés qui s’en chargent. Et ils doivent être tenus en laisse. Le premier objectif est atteint.
Les grands équilibres macro-économiques n’ont jamais été de la responsabilité solitaire des banques centrales. Tous les moyens de l’Etat moderne doivent concourir à l’exercice. Un mix raisonnable entre politique monétaire, politique budgétaire et fiscale, et politique sociale doit être construit.
Le FMI redevient, dans un tel système, l’observateur naturel des déséquilibres croisés et doit y mettre fin.
Du coup la coopération internationale devient le mode de fonctionnement normal de l’économie monde.
Faute d’aller aussi loin qu’il serait nécessaire, la BRI passe pour un mauvais coucheur qui empêche les bonnes nations éprises de keynésianisme de créer de la monnaie et de la dette sans limite, seule solution pour redémarrer la croissance dans la joie et le bonheur pour toute une couche d’économistes de la facilité.
Nous proposons d’appeler « économies baudruches » les économies qui dépassent 300% de dettes globales par rapport au PIB. Dans de telles économies, rien ne se passe selon les théories valables pour des économies où on ne dépasse pas 100 à 150% d’endettement global.
Dans une économie-baudruche les règles d’investissement habituelles ne fonctionnent pas. La raison en est simple : les gains de production (le compte d’exploitation) ne permettent pas de rembourser le principal et les intérêts. Par conséquent la dette qui est créée ne peut se justifier que de deux façons :
- Par l’absence de tout espoir de remboursement : on crée de la dette perpétuelle par création monétaire
- Par l’espoir d’une plus-value, ce qui suppose une bulle sur une classe quelconque d’actifs.
On comprend que tous ceux qui sont accrochés à des rémunérations d’Etat prêchent pour le financement monétaire de déficits publics de plus en plus monstrueux.
On comprend aussi que tous ceux qui ne peuvent espérer de gains sur crédits que sur une plus-value d’actifs, poussent à un gonflement perpétuel de l’alimentation monétaire par les banques centrales.
Lorsqu’une récession cyclique « normale » touche une économie globale non encore boursouflée, et organisée autour de changes fixes, ouvrir temporairement le déficit budgétaire et financer l’activité par la création monétaire est efficace.
Le faire dans un système de changes flottants où tous les mouvements de capitaux sont libres et les décisions portant sur les changes non coordonnées, alors qu’on reste autour de 400% de dettes globales par rapport au PIB, comme dans le G7, ne conduit qu’à une fuite en avant sans fin avec des déséquilibres persistants. Cela fait maintenant 7 ans qu’on a ouvert toutes les vannes. Sans autre effet que d’avoir stabilisé le taux de dettes global à son niveau le plus élevé tout en ayant mis les Etats sous oxygène fiscal pour ne pas être étouffés par des dettes qui continuent à croître.
L’économie réelle reste anémiée, asphyxiée par les dettes et la fiscalité. L’argent ne va pas vers la production. Seulement vers des potentiels de plus-values sur classe d’actifs sensibles à l’alimentation monétaire ou vers les Etats pour payer leurs dépenses courantes.
En indiquant que le maintien d’une politique de fuite en avant dans la dette et la dépense publique incontrôlée grâce à une sur-alimentation en monnaie banque centrale, sans aucune vraie réforme, ne conduit à rien de bon, la BRI a raison et naturellement attire toutes les critiques des Martin Wolf, Krugman etc. qui voient de tout temps la solution miracle dans le déversement de milliers de milliards en monnaie banque centrale dans les marchés et dans les budgets d’état.
Son tort est de ne pas aller jusqu’au bout du raisonnement : il faut mettre fin à la liberté absolue des mouvements de capitaux et la subordonner à la gestion ordonnée de changes fixes mais ajustables, avec interdiction des déficits et des excédents massifs de balances extérieures. A partir du moment où les Etats sont responsables de leurs comptes extérieurs, la fuite en avant dans les déficits n’est plus possible, les gains de plus-value se réduisent, un horizon économique apparait qui permet d’envisager à nouveau des investissements et une reflation coordonnée a une chance de fonctionner au service de l’activité et non pas de la spéculation.
La deuxième erreur de la BRI est de croire qu’il existe deux types de cycles différents : les cycles courts « commerciaux » de 8 ans et les cycles financiers » de 20 ans environ. En fait il n’y a qu’un mécanisme cyclique de 8 -10 ans avec des crises alternativement dures ou molles. Lorsque le souvenir d’une crise dure est dans la tête, les excès de crédit restent mesurés : la crise sera faible. Lorsqu’on a oublié ce qu’est une crise dure, et il faut 15 à 20 ans pour cela, soit l’apparition d’une génération ignorante aux commandes, l’emballement des crédits devient extrême et le réajustement est important. Cela fait plus de 200 ans que cela marche comme cela.
Les économistes et responsables de la BRI sont sur le bon chemin. Il faut qu’ils acceptent de faire un pas de plus en avant. On se souvient que dans le film « les aventuriers de l’arche perdue », l’accès au Graal supposait de marcher avec confiance sur une passerelle invisible.
Certains croient qu’abandonner les changes flottants serait un saut dans le précipice. Ce n’est pas le cas. Dès que le premier pas aura été fait, la passerelle s’illuminera et on sortira enfin de cette crise actuellement sans solution dans le cadre actuel.
Didier Dufau pour le Cercle des Economistes e-toile.

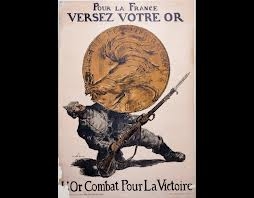

 Voir nos autres blogs
Voir nos autres blogs